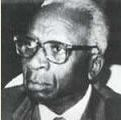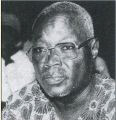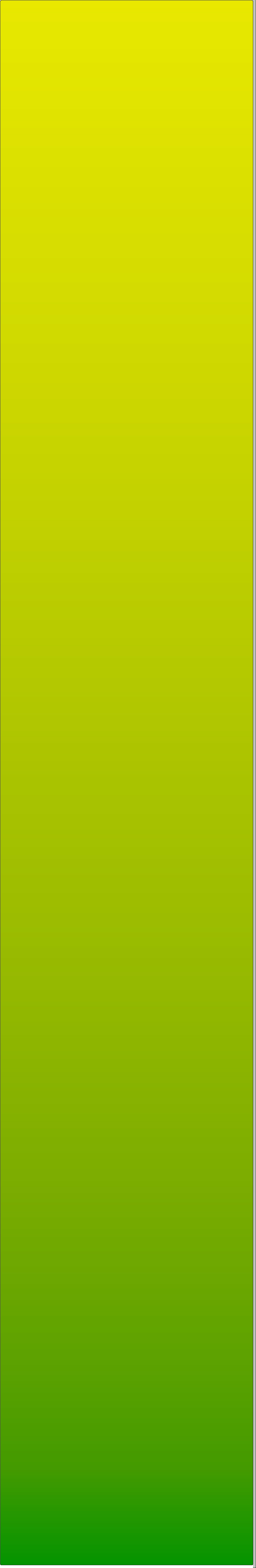Site réalisé par Stéphane Laborde-Clauzel (Aptitudes 84). Pour me contacter, cliquez ici. Merci. CONTACT WEBMASTER
La République du Bénin (depuis 1991).
Nicéphore Soglo rétablit le Vaudou, pour se concilier les pouvoirs traditionnels, et fait du 10 Janvier de chaque année la Journée Nationale du Vaudou. Cependant, les ajustements structurels et la compression des dépenses publiques recommandées par le FMI viennent raviver le mécontentement général de la population. En outre, les trafics clandestins s'épanouissent au grand jour (whisky, essence, ciment, voitures, etc...).
Après avoir perdu sa majorité au sein de l'Assemblée Nationale, le Président Nicéphore Soglo, accusé de népotisme par ses adversaires, est battu par Mathieu Kérékou à la présidentielle du 17 Mars 1996. C'est un choc pour Nicéphore Soglo qui, après avoir crié au complot, envoie ses félicitations au vainqueur et s'en va méditer plus de 4 mois, hors d'Afrique, des raisons de ses erreurs fatales.
Démocratiquement, Mathieu Kérékou est de retour sur la scène politique béninoise, après avoir dirigé le pays pendant 17 ans dans le fiasco politique et économique de la désormais encienne République Populaire du Bénin.
Les élection législatives de Mars 1999 donnent de justesse la victoire à la Renaissance du bénin (RB), le mouvement de l'oppositon dirigé par Rosine Soglo, épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo.
Malgré tout, en Mars 2001, Mathieu Kérékou est réélu Président de la République avec 84,06% des voix. Arrivé en tête du premier tour, face à son prédécesseur Nicéphore Soglo, il sera confronté au désistemetn de ce dernier, ainsi qu'à celui d'Adrien Houngbedji, les 2 candidats qualifiant le scrutin de "mascarade".
Terni par des soupçons de fraudes électorales et âgé de 67 ans, Mathieu Kérékou entame donc un second mandat consécutif dans des conditions économiques fragiles.
Depuis 2001, le Bénin est plongé dans de graves difficulté, en raison de la situation dificile du Port autonome de Cotonou, du choc pétrolier, de la crise du secteur du coton, de la contrebande très étendue, des effectifs pléthoriques de l'administration et des sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité, créés par les sécheresse. Le Bénin est dans une période économique difficile que seule l'agriculture, très diversifiée, parvient à maintenir compétitif face à ses voisins.
C'est ainsi que, lors des élections de Mars 2006, les Béninois décident d'exprimer leur "ras-le-bol" et que le novice en politique, l'ancient président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, le docteur Thomas Yayi Boni succède à la surprise générale à Mathieu Kérékou avec 75% des suffrages.
Mathieu Kérékou, qui a refusé de changer la Constitution, n'a pas pu se représenter.
Thomas Yayi Boni, jugé trop novice par son prédécesseur, dirige le pays depuis..
La République Populaire du Bénin (1972-1991).
Le 26 Décembre 1972, le Commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et destitue le Conseil présidentiel.
Les militaires sont toutefois désemparés, sans programme et sans idées. Leur pouvoir est vide et c'est dans ce vide que s'engouffrent les idées des jeunes militaires et des étudiants qui ont vécu en France la période de Mai 1968.
En Novembre 1974, à la surprise du peuple, des notables et autres diplomates, Mathieu Kérékou décide de diriger le pays dans la voie du Marxisme-Léninisme.
En 1975, pour réduire le poids politique du Sud, le nom de Dahomey est symboliquement abandonné pour celui de Bénin, du nom du royaume qui s'était autrefois épanoui au Nigeria voisin. Le pays devient "La République Populaire du Bénin".
Mathieu Kérékou interdit le Vaudou, la religion traditionnelle bien implantée dans le Sud. Une nouvelle Constitution, instaurant un régime à parti unique, est promulguée en 1977. La même année, une tentative de coup d'Etat appuyée par des mercenaires échoue et durcit le régime, qui devient militaro-marxiste.
Malgré tout, le marxisme-béninisme (marxisme-léninisme adapté au pays) s'avère moins mauvais que d'autres, et on s'apitoie davantage sur le sort des voisins Togolais que sur le sien.
Le Bénin tenta de vastes programmes de développement économique et social, mais sans de bons résultats à l'arrivée. Signe de pragmatisme et de modération, les 3 anciens présidents, Maga, Apithy et Ahomadegbé, emprisonnés en 1972, sont libérés en 1981.
Elu président de l'Assemblée Nationale Révolutionnaire en 1980, réélu en 1984, Mathieu Kérékou échappe à 3 tentatives de coup d'Etat en 1988.
En 1987, les plans du FMI imposent des mesures économiques draconiennes: prélèvements supplémentaires de 10% sur les salaires, gel des embauches, mises à la retraite d'office. En 1989, un nouvel accord avec le FMI sur un programme d'ajustement des structures économiques déclenche une grève massive des étudiants et des fonctionnaires, réclamant le paiement de leurs salaires et de leurs bourses.
A la fin des années 1980, le pouvoir populaire n'a guère plus que quelques milliers de convaincus, une petite douzaine dit la rumeur. On finit par se demander s'il y a encore quelqu'un qui croit vraiment à ce marxisme proclamé du jour au lendemain, sans que l'ex-Union Soviétique y ait imposé quelque chose.
C'est ainsi que les troubles sociaux et politiques vont conduire Mathier Kéréjou à renoncer à l'idéologie marxiste-léniniste et à accepter l'instauration d'une Conférence Nationale, réunissant les représentant des différents mouvements politiques.
On ne garde de l'ancien régime que le nom de Bénin, qui sonne bien. La Conférence est une véritable réussite démocratique: Mathieu Kérékou déclare même "j'accepte toutes les conclusions de vos travaux". Une nouvelle Constitution est établie.
Un gouvernement de transition, mis en place en 1990, ouvre la voie au retour de la démocratie et du multipartisme. Le Premier Ministre, Nicéphore Soglo, bat Mathieu Kérékou à l'élection présidentielle de Mars 1991.
Le Dahomey indépendant (1960-1972).
Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey accède à l'Indépendance en 1960, le 1er Août: une nouvelle constitution est adoptée et le chef du gouvernement, Hubert Maga(1), devient Président de la République.
Pour éviter les effets néfastes du tripartisme dahoméen, un parti unique (le Parti Dahoméen de l'Unité) est formé, mais des troubles sociaux et politiques entraînent le coup d'Etat militaire du 28 Octobre 1963, par le Colonel Christophe Soglo (2).
En Janvier 1964, le pays revient à la gestion civile: Sourou Migan Apithy(3), puis Justin Ahomadegbé(4) assurent les fonctions de Présidents. Mais une nouvelle crise politique conduit les militaires à reprendre le pouvoir: le Général Christophe Soglo (5) préside alors un Comité de Rénovation Nationale, qui entreprend d'assainir l'économie et les finances du pays.
Des grèves éclatent en 1967: le gouvernement est renversé le 17 Décembre par le Commandant Maurice Kouandete(6), qui met en place un Comité Révolutionnaire chargé de superviser l'action du gouvernement provisoire, de constituer une commission constitutionnelle et de contrôler les biens des anciens gouvernants. La nouvelle Constitution, approuvée le 31 Mars 1968, établit un régime de type présidentiel. Emile Derlin Zinsou(7) devient président. Il est renversé par un nouveau coup d'Etat, qui le remplace par une direction militaire le 10 Décembre 1968.
Un Conseil présidentiel composé des 3 partis traditionnels est instauré le 7 Mai 1970: il met en place une organisation devant permettre la cohabitation des 3 chefs des partis traditionnels.
La Colonie du Dahomey.
Au début du XXe siècle, les 3 royaumes cessent d'être autonomes et sont confondus dans un ensemble divisé en cercles, gérés par des administrateurs, et en cantons dirigés par des chefs africains.
Pendant la Première Guerre Mondiale, des troubles éclatent dans le Nord du pays, après l'envoi de troupes autochtones sur le front européen.
A la fin de la guerre, la colonie se structure: les moyens de communication se développent, la production agricole se rationalise et la scolarisation augmente.
Sous l'influence de missions catholiques et protestantes et de l'enseignement laïc, un enseignement primaire et secondaire se met en place. Intégrés dans l'Afrique Occidentale Française (AOF), les Dahoméens entrent dans la fonction publique et servent dans d'autres territoires de la fédération: on qualifie souvent le pays de "Quartier Latin de l'Afrique".
La Conférence de Brazzaville.
Le 8 Février 1944, se termine à Brazzaville une conférence réunissant les 18 gouverneurs et gouverneurs généraux de l'Afrique Occidentale Française, de l'Afrique Equatoriale Française, de la Côte Française des Somalis, de Madagascar et de la Réunion.
Sous la présidence de René Plevent, commissaire des Colonies du Comité Français de la Libération Nationale, cette réunion a pour mission d'émettre des recommandations sur la future législation coloniale. La présence du Général De Gaulle et la tenue d'une telle réunion alors que la guerre est loin d'être terminée montre le réel intérêt porté à l'avenir de ces territoires, qui apparaisent alors comme l'incarnation de la permance de la République hors du territoire métropolitain.
Il ressort de Brazzaville l'idée d'une participation accrue de la population africaine à la vie politique et le désir d'abandonner les régimes d'exceptions auxquels elle est alors soumise, comme le code de l'indigénat.
Vers l'Indépendance.
Le Dahomey devient un Etat autonome au sein de la Communauté Française.
Le pays accéda à l'Indépendance le 1er Août 1960 et entra le mois suivant aux Nations Unis.
Le Peuplement.
Le pays est constitué de 2 aires géographiques:
- Le Nord ( aujourd'hui frontalier du Niger et du Burkina Faso), qui a connu le destin des peuples de la savane.
- Le Sud et le centre du pays, marqués par l'histoire des peuples du Golfe de Guinée.
On retrouve cette opposition dans les qualificatifs "Afrique des greniers" et "Afrique des paniers". Le premier fait référence au greniers de maïs ou de mil qu'on trouve dans le domaine des savanes africaines, comme au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Le second se situe autour de l'équateur et correspond, en Afrique Occidentale, au sud de tous les pays littoraux du Golfe de Guinée: dans ces derniers, en raison du climat équatorial favorable à l'agriculture, rien ne sert d'entreposer puisqu'il suffit juste de "porter'.
Jusqu'au XVe siècle, de nombreux peuples de la savane s'installent au Nord:
- Bariba ou Baatombu.
- Dendi.
- Djerma.
- Groussi.
- Haoussa.
- Mossi.
- Paragourma.
- Peuls ou Fulbe.
Alors que des populations littorales s'installent au Sud et au Centre:
- Fon et Aja ou Adja.
- Ewé.
- Gen.
- Mina.
- Yoruba.
L'Organisation Sociale Ancienne.
Les communautés anciennes se structurent sur leurs lignages. Vivant sur des territoires restreints, ces populations n'ont pas besoin d'organisation politique; quant à leur organisation sociale, elle se base sur le respect des coutumes et des ancètres morts. L'autorité s'y exerce oralement par le partage de ces traditions. On trouve toujours de telles populations dans le Nord-Ouest du pays: Berba, Kabiyé ou Tanéka.
Lorsque plusieurs lignées se regroupent, elles se structurent en chefferies: le chef peut être un représentant d'une famille ancienne ou un prêtre. Il s'entoure de dignitaires, chargés chacun d'une activité collective et formant un conseil.
A partir du XVe siècle, la structure sociale se complexifie et des royaumes apparaissent, dégageant ainsi 3 grandes aires culturelles: Bariba au Nord, Yoruba et Aja-Ewé au Sud.
Les Royaumes Bariba.
Le Nord du pays a connu plusieurs royaumes bariba et, notamment, le Royaume de Nikki. C'est à partir de ce village du Nord-Est qu'une dynastie, créée au XVIe siècle par Sunon Séro, étendit sa domination sur la région. Son dernier Roi, Séro Kpéra, meurt en 1831 en combattant aux côtés des Yorubas d'Oyo (Nigeria) les attaques des Peuls. Le royaume est désorganisé quand les armées coloniales l'envahissent à la fin du XiXe siècle.
Leurs sociétés sont structurées en classes sociales strictes: nobles guerriers, griots, agriculteurs roturiers, artisans et esclaves.
Les Royaumes Yoruba.
L'aire d'influence des Yoruba couvre l'Est du pays et est constituée de 2 royaumes: le Royaume de Shabê-Okpa et le Royaume de Kétou. Ces 2 royaumes ont été créés par 2 frères descendants du roi d'Ifé Okandi. A côté de ces 2 royaumes, on retrouve une population Yoruba d'émigration plus ancienne (les Datcha, les Ifé, les Isba et les Manigri).
Les Aja-Ewé.
Selon d'anciennes traditions orales et écrites, les Aja-Ewé émigrent à partir du XIVe siècle de la ville de Tado, située sur les rives du fleuve Mono au Togo. Ils établissent dans le Sud 2 royaumes: à Sahé (ou Savi) et à Davié (devenue Allada plus tard).
Vers 1620, les héritiers du Royaume d'Allada se disputent le trône; de cette querelle naissent 2 royaumes supplémentaires: au Sud-Est, Zozérigbé crée le Royaume de Hogbonoou (à Adjatché, devenue Porto-Novo plus tard) et, au Nord, Houégbadja institue le Royaume du Dahomey à partir de sa capitale, Abomey.
Au XVIIIe siècle, une série de conquêtes se fait sous l'autorité de 12 rois traditionnels, à commencer par Gangnihessou. En 1724, Agadja, Roi du Dahomey, s'empare du Royaume d'Allada; en 1727, il soumet celui de Savi. En 1741, c'est au tour de Ouidah de tomber sous le joug de son successeur, Tegbessou.
Le pays dispose désormais d'une large fenêtre sur la mer. Le Royaume a pris l'habitude d'échanger, commercialement et politiquement, avec les Portugais et les Hollandais, arrivés à la fin du XVe siècle. Le Dahomey devient une entité politique organisée.
Dès le XVIIe siècle, ces royaumes, structurés autour des villes d'Allada, Hogbonou et Abomey, prospèrent avec le développement du commerce local. Néerlandais, Portugais, Danois, Anglais et Français installent le long de la "Côte des Esclaves" des comptoirs commerciaux en toute impunité.
Dans la premère partie du XIXe siècle, le Roi Guézo d'Abomey développe la culture du palmier à huile et introduit de nouvelles cultures (maïs, tomates, arachides, tabac).
Au XVIIIe siècle, Allada et Ouidah furent annexées. Les Européens développèrent des forts sur la côte, comme des bases militaires, afin d'imposer aux ethnies côtières une menace militaire pour qu'elles leur fournissent des esclaves.
C'est le Roi Ghézo qui consolida le Royaume, en attaquant régulièrement les Yoruba au Nigeria, ce qui lui procurait des esclaves. Son successeur, le Roi Glélé, irrita cependant les Français par son attitude belliqueuse et son attitude non conformiste. Par le Traité de 1863, il autorisa les Français à s'installer à Cotonou. Toutefois, la présence de ceux-ci irritait le Roi Gbê han zin (ou Behanzin) qui estimait que les Français menaçaient la souveraineté de son royaume; de nos jour, à l'entrée de la ville d'Abomey, une statue géante du roi illustre cette lutte contre l'envahisseur. Le Traité de Ouidah, signé en Octobre 1890, place Porto-Novo et Cotonou sous tutelle française, ce même traité prévoyant le versement par la France d'une pension au Roi d'Abomey. Le Roi Béhanzin et les Danxoméens estimaient Porto-Novo et le Roi Toffa Ier comme des traitres à la solde des Français; il fut défait en 1892 par le Colonel Alfred-Amédée Dodds et déporté aux Antilles. Abomey devint alors un protectorat français. Allada et Porto-Novo, eux aussi sous protectorat, formèrent avec Abomey la Colonie du Dahomey.
Afin d'écouter l'Hymne National de la Répuplique du Bénin, merci de cliquer sur le bouton "Lecture".
L'Hymne National du Bénin a pour nom "L'Aube Nouvelle". Il a été écrit et composé par l'Abbé Gilbert Jean Dagnon et adopté lors de l'Indépendance du Dahomey en 1960.
Quand en 1975, le Dahomey a été rebaptisé en Bénin, l'hymne national a été conservé, les occurences des mots 'Dahomey' et 'Dahoméens' étant replacées respectivement par 'Bénin' et 'Béninois', ce qui explique que certains alexandrins de l'hymne n'ont plus à présent que 11 syllabes.